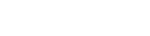"Roots in a Fast Place": les pratiques créatives dans l'espace public par Katie Bachler et Allison Danielle Behrstock* (traduit par Aurélie Foisil)
Depuis plusieurs années, l’artiste et architecte Marjetica Potrč fait évoluer sa pratique autour de «projets in situ». Sa démarche promeut le principe de justice sociale et appelle à la collaboration avec différentes communautés. Ses projets invoquent un savoir en rapport avec un lieu, comme point de départ d’une émancipation de la communauté, en réponse à des problèmes locaux. Marjetica Potrč travaille selon des stratégies participatoires et des structures horizontales de travail et d’échange. Elle voit son travail non seulement comme un héritage de la sculpture sociale, mais aussi comme une production collective de ce qu’elle appelle les «objets relationnels». Les projets sont d’abord inscrits dans le long terme. Puis, afin de faire émerger les problèmes-clés, Marjetica Potrč collabore avec différents acteurs culturels et sociaux comme les municipalités, les établissements artistiques, les activistes, les artistes et les scientifiques. Elle recherche et utilise différents modèles de participation, d’engagement, de partage de savoirs et d’action citoyenne dans ce qu’elle nomme une «pratique redirectrice». L’idée est que tout changement commence dans la communauté même, que les initiatives venant de la base et allant vers le haut, prises comme un tout, créent une masse critique qui, à grande échelle, se révèle pleinement efficace. En tant qu’artiste, elle se voit comme catalyseur social, instigatrice d’une nouvelle dynamique sociale dans la communauté, et porte-voix pour la multitude.
Les projets in situ de Marjetica Potrč sont alimentés par sa conception de l’art en tant qu’outil de changement social. Son but est de développer un «objet relationnel» en collaboration avec les individus à l’échelle locale. L’une des questions essentielles qu’elle pose à travers ses projets est: «Comment vivre ensemble?» L’objet relationnel va aider à répondre à la question en devenant un catalyseur d’interaction sociale ou encore un élément qui va ramener les individus dans un espace partagé, en jouant le rôle de lien social. Le jardin joue ce rôle d’objet relationnel, comme on peut le voir actuellement dans son projet La Semeuse aux Laboratoires d’Aubervilliers. Dans son initiative de 2009 The Cook, the Farmer, his Wife and their Neighbor («Le cuisinier, le fermier, sa femme et leur voisin»), un jardin et une cuisine communautaires ont été créés en collaboration avec le collectif Wilde Westen à Nieuw-West dans la banlieue d’Amsterdam, comme projet hors les murs du Stedelijk Museum. Nieuw-West et Aubervilliers, à proximité de capitales, ont pour point commun leurs populations immigrées et la menace qui pèse sur celles-ci d’être remplacées par une population plus aisée.
Nieuw-West est un quartier d’immeubles sociaux construits après la seconde guerre mondiale dans le style moderne, et ses espaces verts sont abandonnés. Des structures inachevées à balcons de verre côtoient des bâtiments de logement de Gerrit Reitveld en mauvais état. En même temps que le capitalisme avance dans ce quartier risquant de perdre ses traditions, le jardin et la petite cuisine du projet font entrer la ferme à la ville et le passé dans le présent.
Dans les projets de La Semeuse et du Cuisinier…, «l’objet relationnel» du jardin est un espace réel, et non imaginaire, un terreau fertile pour les relations humaines. Les jardins deviennent les symboles d’une culture extensive où les catégories sociales et les cultures se mélangent de façon organique. À Amsterdam, «le jardin et la cuisine communautaires tissent des liens au sein de la communauté. Les habitants du quartier donnent à la cuisine la moitié de ce qu’ils produisent dans le jardin, ce qui transforme ces espaces en catalyseurs qui modifient non seulement l’espace public, mais aussi la communauté elle-même»¹. Marjetica Potrč a vécu six mois dans le Nieuw-West avant que le projet ne commence, en tissant progressivement ses relations et son réseau, en intervenant auprès des promoteurs publics comme auprès des associations de femmes musulmanes, qui sont devenus parties prenantes du jardin et de la cuisine. En tant qu’objet relationnel, le jardin repose sur l’idée d’un échafaudage horizontal qui offre un maillage où se nouent les relations sociales. La force qui fait marcher ce projet vient des gens, des différents publics qui se rassemblent, partagent leur savoir et produisent leur nourriture. Il s’agit d’un espace qui s’ouvre pour de nouvelles traditions, pour le souvenir, pour recréer ses racines, en même temps que s’effacent douloureusement une histoire ou une culture.
Dans un musée, les visiteurs se poseraient la question: «Est-ce bien de l’art?» Marjetica Potrč et ses collaborateurs considèrent l’objet de leur démarche non pas comme une «sculpture-objet», mais comme un «objet relationnel». Ceci remet en question tous nos modes de production et nos attentes sur l’objet en tant que tel. Nous sommes face à une expérience qui est en rupture avec l’idée du visiteur et de l’œuvre d’art passifs dans l’espace du musée. L’œuvre, objet relationnel, implique une participation et une activation qui ne seraient pas possibles sans les habitants du quartier. Marjetica Potrč se décrit comme une artiste-médiatrice et considère l’art comme «un médium autour duquel l’individu et la culture se rejoignent»². Roy, un homme du Surinam qui aime travailler en extérieur, est devenu le gérant salarié du jardin. L’après-midi, les femmes musulmanes sont à la cuisine communautaire et offrent du café, des petits gâteaux et font la conversation. Le jardin est devenu un endroit pour que les gens réinventent leur histoire. Marjetica Potrč a fourni le cadre conceptuel et matériel du jardin, et les habitants s’y sont rencontrés et se sont appropriés ce cadre. Ils ont repris la gestion du projet à la suite du Stedelijk Museum. De projet artistique, le jardin est devenu un bien communautaire.
Le travail de Marjetica Potrč s’inscrit dans un mouvement d’artistes pour lesquels la nature et l’agriculture doivent être des éléments importants du paysage urbain. Cette idée de l’art engagé dans la sphère sociale est venue des années soixante-dix, avec la promotion du Whole Earth Catalog et le mouvement hippie. L’artiste Bonnie Sherk a créé des jardins communautaires et élevé des poules sous un nœud d’autoroutes à San Fransisco, dans un endroit qu'elle a baptisé Crossroads Community (The Farm) (1974-1980). Bonnie Sherk décrit son travail comme un système intégré dans un tout homogène. Selon ses mots, c’est une «idéologie incarnée dans un microcosme, soit à partir d’une situation préexistante, soit à partir d’une situation orchestrée par l’artiste et qui utilise parfois l’art comme outil pour créer un tout homogène»³. Elle explique ici que les systèmes ont besoin d’être mis en perspective par un simple déplacement des pratiques spatiales et pas seulement à travers une œuvre d’art. Le système des valeurs est déplacé, à partir d’un noeud d’autoroutes (moyen) où se meuvent des personnes (finalité), vers un écosystème avec un espace visuellement agréable et écologiquement viable, un espace de production agricole, un espace où les gens peuvent simplement être. Au-delà de l’expérience immédiate, l’art offre un cadre à toutes les expériences, à travers le concept de ce que Bonnie Sherk appelle le cadre-vie, sorte de lentille pour mieux regarder la réalité. Cette pratique nous permet de retrouver la nature en ville et de poursuivre l’expérience même après avoir quitté The Farm.
L’artiste Joseph Beuys, né en Allemagne, a travaillé sur des thèmes qui mettaient en lumière les cycles de la nature et de la croissance. En parlant de son œuvre 7000 chênes, inaugurée à la Documenta 7 en Allemagne en 1982, il a dit : «Je pense qu’il faut planter ces chênes non seulement pour la biosphère, c’est à dire dans un contexte écologique, mais pour éveiller les consciences écologiques – ce qui va arriver de manière décuplée dans les années à venir, car nous n’allons jamais nous arrêter de planter»⁴. Se réaliser socialement, c’est se connecter à la terre, c’est «aller dans la direction qui façonne le monde du futur»⁵. Beuys est le fondateur du parti vert allemand. Il a créé des œuvres qui ont proposé aux gens de s’organiser pour se rapprocher de la nature.
Au XXIème siècle, il faut trouver un autre moyen d’être en relation avec les paysages et les individus. Les artistes peuvent être les instigateurs de projets qui tentent de reconnecter les individus entre eux grâce au canevas d’une agriculture communautaire. Prenons le projet de Fritz Haeg Edible Estates: les pelouses semées devant des maisons de ville ou de banlieue sont remplacées par des jardins maraîchers, un processus maintes fois repris à travers la planète. Fritz Haeg, comme Marjetica Potrč, a une formation d’architecte, et a récemment dit: «Les bâtiments m’ennuient en ce moment. Il n’y a plus que les gens qui ont de l’argent qui décident comment on doit construire actuellement et à quoi les constructions doivent ressembler. Mais chacun de nous peut sortir demain, planter une graine dans le sol et avoir un impact sur le futur de sa ville. Les jardins sont les premiers lieux où le citadin peut s’engager. Le jardinage est un acte politique»⁶. Les jardins sont des espaces qui exigent une participation si l’on veut qu’ils subsistent. Fritz Haeg est passé des idées sur les bâtiments aux idées sur les gens de la manière suivante: une architecture sociale se crée autour d’un jardin qui concentre les interactions positives pour nourrir les habitants et plus largement, la communauté. Il observe le retour d’un rituel qui consiste à produire sa nourriture en ville, s’inspirant des Victory Gardens de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis et en Angleterre, au temps où l’austérité était de mise et où cultiver ses propres légumes était encouragé au même titre que le patriotisme. De quelque chose qu’on admire de loin, ou qu’on ne remarque pas, Fritz Haeg transforme la pelouse en un espace avec des racines et une politique, elle devient un jardin qui implique l’engagement.
À l’instar de Marjetica Potrč et de sa «pratique redirectrice» ainsi que des structures à fonctionnement horizontal, l’Atelier d’architecture autogérée (AAA), collectif parisien d’architectes, de théoriciens et d’activistes propose «des pratiques interstitielles qui explorent les potentialités des villes contemporaines», qu’ils décrivent comme «une action micropolitique», un effort collectif pour «participer à rendre la ville plus écologique et plus démocratique, à rendre les espaces de proximité moins dépendants des processus par le haut (vers le bas) et plus accessibles à leurs usagers»⁷. L’«architecture autogérée» est une architecture de relations, de processus et d’agencements de personnes, de désirs, de savoir-faire. AAA crée à Paris de nouvelles géographies de quartiers, représente sous des formes inhabituelles les données récoltées auprès des habitants, des représentants et des organismes locaux et bouleverse les modèles traditionnels de pouvoir vertical de l’urbanisme et de l’architecture.
En tant qu’artistes, Fritz Haeg, Marjetica Potrč, Bonnie Sherk, Joseph Beuys et AAA jouent tous le rôle de ce que l’artiste, théoricienne et critique Claire Pentecost appellerait «l’amateur public». Celle-ci s’explique: «Quelqu’un décide de remettre en question un élément dans une autre discipline que la sienne, d’en acquérir une connaissance de façon détournée et d’oser proposer d’autres interprétations de ce savoir, surtout en ce qui concerne les questions ayant un impact décisif sur nos vies»⁸. L’artiste devient alors un puissant médiateur, un négociateur ou facilitateur de dialogue et une source d’information. Même s’il est difficile de généraliser cette idée à la diversité des pratiques mises en oeuvre par ces artistes, ceux-ci partagent une même préoccupation pour nos problèmes d’accès et d’égalité de traitement face à l’utilisation des sols et pour notre relation d’interdépendance avec la nature. Cependant, leur travail n’est pas tout de suite perçu comme de l’art ; leur pratique se confond plutôt avec les grands principes de la justice sociale et de l’urbanisme. C’est la valeur de leur travail qui est reconnue, qu’il soit ou non perçu comme de l’art. Le travail de ces artistes invite les gens à participer à des processus de vie en commun, à réfléchir sur la nature et sur la manière de vivre avec elle. Ces artistes créent des espaces physiques pour accueillir de futurs savoirs, comme se reconnecter à la terre à travers des systèmes vivants.
Le projet de La Semeuse a été élaboré en s’appuyant sur l’observation du terme-phare du XXIème siècle, la biodiversité. La commune d’Aubervilliers est une des zones d’Europe les plus aux prises avec la diversité, avec plus de 130 nationalités décomptées. La Semeuse fait voyager le thème controversé de l’immigration à travers l’espace sécurisant du jardin. Les personnes arrivant d’ailleurs transportent avec elles des traditions culinaires, souvent aussi des graines et de nombreuses expériences. Elles viennent représenter leur chez-soi dans un nouvel environnement. La Semeuse est un espace de partage de plantes, de nourriture, de cycles de croissance et de mutation. En posant des questions sur les plantes, comme «Qu'est-ce qu'une plante indigène?» et en créant un espace commun pour elles, ces personnes nous révèlent toute une série d’autres questions. Parler des plantes, c’est parler des gens.
À Aubervilliers, La Semeuse imagine un futur équitable en réaction à l’avancée des classes aisées et des promoteurs immobiliers sur la ville. Le projet propose de repenser l’équilibre entre les espaces construits et vacants du paysage urbain. La Semeuse permet de réunir nature et culture, de mettre du lien entre nature et individu, de reformuler la conception de plante indi- et allo-gène pour mettre l’accent sur le déplacement des graines, la biodiversité et la diversité culturelle. Comment pouvons-nous progresser tout en nous occupant de nos racines et en les laissant pousser? Le jardin devient la métaphore de notre enracinement dans un nouveau terreau, et de la manière dont des choses différentes peuvent créer un tout homogène.
Texte publié dans le Journal des Laboratoires, mai-août 2012