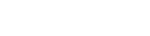Pour une approche renouvelée de l’interstice
Ariane Leblanc, coordinatrice de La Semeuse
publié dans Le Journal des Laboratoires - Année 2018/2019
Un organisme et son milieu naturel constituent le binôme fondamental de l’écologie. L’environnement, composé d’une diversité animale et végétale, se transforme constamment, au gré des interactions qui les lient entre elles et avec leur territoire. Cette modification permanente soutient, en retour, le développement de la diversité. Le milieu influe sur l’organisme et l’organisme influe sur le milieu.
Aujourd’hui, à l’échelle des villes globalisées, les corps vivants sont déterritorialisés : ils sont coupés de leur milieu, n’interagissent plus qu’avec des plans d’aménagement urbain conduits par des politiques néolibérales, elles-mêmes héritées d’une pensée colonialiste, de fragmentation et de cloisonnement des espaces et des corps.
Comment repenser une expérience de l’habitat qui puisse reconnecter corps et milieu ? Quelles sont les relations à inventer, à cette fin, entre milieu et organismes humains et non-humains ?
Les nombreuses rencontres, pratiques et théoriques, menées par La Semeuse, plateforme de recherche pour une biodiversité urbaine, ont permis de dégager quelques pistes de réponse. Ce projet s’inscrit, à Aubervilliers, dans un contexte de transition urbaine menée dans le cadre d’une politique du Grand Paris révélatrice des rapports de pouvoir qui sous-tendent les planifications urbaines en général.
Depuis le milieu des années 1980, la politique urbaine néolibérale organise les ressources naturelles et économiques en pôles de croissance
« entrepreneuriale » dynamiques : « les pôles de compétitivité [1] ». L’urbanisation est intrinsèquement liée au capital : le capital administre les flux humains vers ces différents pôles de compétitivité. Dans un monde globalisé, structuré autour de métropoles, ces flux, transfrontaliers, visent à mettre le plus directement possible des villes en réseaux. Sa fluidité et sa vitesse sont la garantie du bon fonctionnement de ce processus, au point que François Asher déclare que « la mobilité […] au cœur du processus d’urbanisation est un principe de la métropolisation et non une de ses conséquences [2] ». Cette mobilité à tout prix participe au désencrage des individus, à leur déterritorialisation au sens de Deleuze et Guattari [3]. Cette nouvelle manière de penser la culture humaine, hors sol, entraîne une redéfinition des rapports que les humains entretiennent entre eux.
Héritage colonial et domestication
La métropolisation suit une idéologie colonialiste, c’est-à-dire un système de domination qui promeut une interprétation unique et globale du monde, ainsi qu’une facilitation des échanges marchands par sectorisation de la production mondiale. Autrement dit, chaque pays se spécialise dans la production de certains produits et se voit contraint d’importer les autres biens et services nécessaires, en fonction des prix du marché. Ce fonctionnement colonial accroît la relation de domination et d’exploitation des sociétés traditionnelles et populations rurales par les populations urbaines. Ces mécanismes de discrimination sociale s’exercent aussi à l’échelle des villes où existe une spatialisation, cette fois, raciale.
L’enjeu territorial constitue, par nature semble-t-il, un enjeu de pouvoir. Comme le dit le philosophe Jean-Baptiste Vidalou, « Gouverner les hommes, c’est gouverner leur milieu [4]. » De nombreuses guerres civiles ont été menées à l’intérieur même des pays pour le contrôle des territoires [5]. Déjà au XVIIIe siècle, les savoir-faire paysans constituaient une question épineuse pour les gouvernements coloniaux. Et au XIXe siècle, en France, les ingénieurs se revendiquaient, pourvus de leur modèle scientifique et de leur vision moderniste, comme les seuls capables de sauvegarder un territoire, proscrivant par là même les pratiques paysannes, qu’ils considéraient comme archaïques. Soit des stratégies guerrières d’homogénéisation et de contrôle des espaces, de domestication des individus et de leur environnement.
La domestication de l’environnement [6] s’inscrit du côté du civilisé, qui, contre le sauvage, prétend quantifier le milieu pour mieux le saisir et l’assujettir. Les espaces urbains se structurent autour de l’opposition entre, d’un côté, une nature devenue désormais un espace mesurable, utilisable à des fins de privatisation et, de l’autre, un végétal qui se développe hors sol. Cette occupation totale des territoires par l’humain ne laisse plus aucune place au milieu naturel sauvage, excepté dans les parcs nationaux où il préserve « une parcelle de verdure ». Mais les individus eux-mêmes subissent cette domestication – ce que Michel Foucault conceptualise via le terme biopolitique [7] : une technologie du pouvoir qui tend à mesurer le vivant, à le rendre davantage lisible et à le discipliner en créant des unités de mesures.
Espace clos
Le mode de gouvernance libéral se manifeste par la fabrique d’espaces clos, dits « sécurisés ». Ces espaces quadrillés, travaillés par le design urbain, influencent les usagers de la ville. L’objectif consiste à les déplacer entre différents espaces fonctionnels, de manière à encourager leur consommation et à ainsi faire circuler le capital. Toute personne ne voulant pas ou n’ayant pas de capital en circulation n’est donc plus utile pour la métropole, et devient un indésirable à évincer.
L’artiste photographe Sandrine Marc questionne cette politique d’inhospitalité et d’ultracirculation à travers sa série de photos Dispositif, réalisée à Paris en 2009. Tout comme le Survival Group avec le travail, « Les anti-sites : excroissances urbaines anti-SDF » [8] c’est en déambulant dans l’espace public qu’ils/elle constatent l’installation de formes antistationnement qui empêchent de s’y installer, d’y stationner. Pensés et désignés pour être le plus discrets possible, ils agissent et influencent la vision de la ville des usagers sans ces derniers en soient forcément conscients. Malgré tout, certains parviennent à en détourner les usages (des sans-abri qui réussissent à y demeurer, voire à y habiter, des jeunes qui les transforment en espaces de jeu). Ces détournements permettent aussi de les rendre d’autant plus visibles.
Quelques années plus tôt, en 2003, Gilles Pâte et Stéphane Argillet réalisaient le film Le Repos du Fakir, qui traite de ces mêmes questions :
Le mobilier urbain est la partie visible d’un urbanisme hygiéniste qui
modèle nos comportements dans les espaces dits publics. On ne peut
plus se regrouper nulle part. On ne peut plus se reposer sur les bancs:
ils glissent. Il en est de même des espaces collectifs des facultés
construites après 68 : pas de rassemblement, pas de réunion (faculté
de Tolbiac, Paris 13e). Cet urbanisme refoule les zonards, les sans-abri,
les jeunes vers des lieux moins contrôlés, hors du centre de Paris, ville
monument obsédée par l'image figée, propre, qu’elle veut donner
d'elle-même [9].
La gestion technocratique actuelle des villes a tendance à ne plus considérer les corps que comme des objets gênant la régulation des flux.
L’expérience de l’habiter
« Être homme veut dire d’abord habiter [10]. » L’humain investit un lieu qu’il valorise mentalement en y associant des significations qu’il peut modifier par son action. Le verbe habiter est riche de sens. D’un côté, c’est la question pragmatique du logement, de la nécessité de l’abri et, de l’autre, celle de la pensée réflexive que l’habitant porte sur ses modes d’habitation. C’est cette dernière caractéristique que je souhaite interroger : l’humain habite lorsqu’il expérimente la signification d’un milieu.
C’est cette perception sensible que l’artiste et chercheuse étudiante en Art esthétique et science de l’art [11] Ingrid Amaro défend, quand elle s’inspire de la philosophie transcendantaliste pour théoriser et expérimenter la conscience vernaculaire comme geste artistique. La philosophe révoque la définition de l’endémisme en s’appuyant sur l’exemple du Sophora toromiro de l’île de Pâques, « arbre endémique » qui s’avère s’être déplacé au Chili. Amaro développe un processus esthétique qui offre une expérience sensible du milieu et des territoires « autres ». S’ancrer dans un lieu, c’est redonner et garantir à la vie ses conditions d’existence, c’est appartenir à un lieu autant qu’il nous appartient. C’est créer une interdépendance.
La notion d’hétérotopie urbaine, telle que développée par Michel Foucault dans sa conférence « Des espaces autres », en 1967, s’ancre physiquement, contrairement à celle d’utopie. Elle se rapporte à des lieux réels caractérisés par une expérience « mixte », « mitoyenne ». L’expérience que l’on en fait, mélangée et ambiguë, se caractérise par des relations subjectives. Cette notion est au cœur de la pensée du lieu public développée par la philosophe Joëlle Zask [14] : un espace dont les usages sont situés, traversé par des usager•ère•s qui le transforment localement. Les relations entre les êtres qui s’y jouent, diverses et déhiérarchisées, élaborent progressivement un sens commun et font communauté. Cela produit des temps de rencontre et d’interaction non déterminés, qui ne sont pas imposés de manière verticale. C’est organicité des relations qui l’agence et le réagence. Sa structure n’est jamais fixe, c’est donc la dynamique qui définit le sens.
« Les territoires récalcitrants [15] », comme les villes de Notre-Dame-des-Landes ou de Bure, sont à l’origine désignés par les pouvoirs publics comme « zone d’aménagement différé [16] ». Cette zone est une procédure qui permet aux collectivités locales, via l’utilisation du droit de préemption particulier [17], d’en assurer progressivement la maîtrise foncière. En sanctuarisant des terrains sur lesquels le plan local d’urbanisme (PLU) prévoit à terme une opération d’aménagement, l’aménageur public évite ainsi que les prix s’envolent. Ce sont ces zones qui sont devenues les fameuses « zones à défendre » par et pour les militants en lutte contre les projets d’aménagement des villes-mondes. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes existe depuis les années 1990. Elle s’est transformée et se transforme selon les récits et les histoires des habitant•e•s et des occupant•e•s. La perception du territoire procède d’une géographie sensible des lieux propre à chacun•e. À l’intérieur, les segments rectilignes n’existent plus, ce sont des enchevêtrements de sentiers qui empruntent la nécessité de la lutte tout autant qu’ils relatent les liens entre les différentes formes de vie. L’autoconstruction des cabanes, de formes et de matières différentes, repositionne la notion de l’habiter en une expérience nouvelle. Elle appartient à son habitant mais s’ouvre aussi à une aventure collective. Habiter devient politique et sensible. C’est la guerre contre toute forme de cartographie, contre les signes et les traces qui indiquent les directions à prendre. Il faut tout effacer pour reconstruire un nouveau rapport au
monde ; des liens se construisent et changent tous les jours, au gré des rencontres, des envies et de la lutte. Habiter se performe car l’espace et le temps ne sont plus simplement mesurables, ils sont à expérimenter.
Perla Serfaty [18], psychosociologue née à Marrakech, définit les caractéristiques fondamentales de l’habiter selon trois principaux aspects : l’instauration d’un dedans et d’un dehors, la question de la visibilité et du secret et enfin, le processus d’appropriation. Cette démarche permet, selon elle, de cerner davantage ce qui constitue le noyau de l’expérience d’habitation. « Habiter » implique que les espaces où la vie se déroule soient des lieux de mémoire, d’ancrage symbolique et dotés d’un caractère particulier et singulier qui les distingue. Vu de la sorte, habiter devient alors un « art du lieu ».