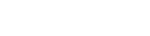Le séminaire critique W est un groupe de travail consacré à l’élaboration d’outils critiques dans les champs de la performance, du théâtre et de la danse. Entre octobre et janvier, il s’est réuni chaque semaine pour analyser collectivement un certain nombre de spectacles à l’aide de protocoles proposés par la critique W. Le texte qui suit est issu de ces séances. Il porte sur Les Justes, mis en scène par Gwénaël Morin d’après le texte d’Albert Camus (au Théâtre de la Bastille du 3 au 23 novembre 2008). Il a été publié dans le numéro de février de la revue Art 21.
Le spectacle aurait pu s’appeler Les Justes d'après Les Justes d’Albert Camus [1]. C'est du moins à cela qu’on s’attendait en se rendant au théâtre de la Bastille [2] qui n'a guère l'habitude de jouer les supplétifs aux programmes scolaires : une adaptation. Une adaptation intelligente, un peu subtile, qui fasse sortir de l’ornière de son manichéisme un texte dont l’«engagement» compte ses soixante ans sonnés. On s’inquiétait même un peu de tant de subtilité promise: pour faire entrer Les Justes - pièce scolaire, pièce à message, pièce au militantisme anachronique, ainsi que nous la restituent d’assez vagues souvenirs – au format souple mais résolument contemporain du théâtre de la Bastille, il allait falloir déployer des trésors de ruse, d’élégantes prises de distance avec l’insoutenable conviction du texte.
C’était sans compter sur le rapport que Gwénaël Morin entretient au texte de théâtre. S’il ne cesse d’en exalter la fonction primordiale (conforme en cela à la tradition théâtrale française), il se garde bien de vouloir le «servir» ou le «respecter» (enfreignant par là même les premiers commandements de ladite tradition). Il revendique bien plutôt de se servir des grands textes (toujours des classiques, «parce qu’on sait qu’ils fonctionnent») pour faire ses spectacles, exactement comme on se sert d’un bon tracteur pour labourer un champ. Comme souvent chez Morin, le texte se voit donc ici clairement représenté en tant que tel, exhibé même, sous la forme d’un livre brandi à bout de bras en amorce de l’action figurée. Cette fonction de représentation du texte en tant que tel est assurée de bout en bout par la même actrice (Mélanie Bourgeois) qui lit systématiquement toutes les didascalies de la pièce. Selon que sa lecture précède ou non les actions des acteurs, elle se fait tantôt description de l’action, tantôt donneuse d’ordres. Elle incarne une distance vis-à-vis de l’action, mais en tant qu’observatrice, elle agit aussi comme un prolongement du spectateur sur scène, et cette position lui permet de guider la lecture du spectacle en s’adressant aux personnages ou bien aux acteurs qui sont en train de les interpréter. Le spectacle peut alors être lu comme un va-et-vient entre une répétition publique et une représentation théâtrale traditionnelle.
Le dispositif scénographique participe de cette indécision: la salle est éclairée par un faux plafond de tubes fluorescents; des bandes de scotch jaune où est imprimé au kilomètre le titre de la pièce forment sur les murs et le mobilier comme des extensions, des amas, des rafistolages qui, combinés à l’ordinaire des accessoires et des matériaux, produisent un effet d’urgence et de précarité. Ce décor, qui mêle éclairage de hangar et signalétique urbaine, étend l’espace scénique à la salle et les spectateurs s’y voient de fait incorporés, encadrés par une lumière crue et comme par un balisage de sécurité. Les scénographies de Morin empruntent délibérément l’esthétique de Thomas Hirschhorn (dont le metteur en scène a été l’assistant, et dont il revendique l’influence), si bien qu’elles donnent souvent le sentiment, quand on les découvre, d’une installation précaire mais déjà très habitée.
L’occupation du plateau et de la salle par les acteurs, avant même le début formel du spectacle, instaure aussi une confusion entre la situation de représentation théâtrale et le tout environnant dont elle ne veut pas tout à fait s’extraire. Produire l’illusion d’une continuité entre l’ordinaire du quotidien et l’extraordinaire du spectacle c’est, dans le travail de Morin, un registre que l’on peut qualifier de naturaliste, si l’on veut bien entendre par ce terme un schéma d’énonciation qui joue sur l’ambiguïté des signes produits par les acteurs, qui peuvent jouer soit comme les indices contingents d’une activité réelle, soit comme des symboles choisis, relevant de codes et de conventions de représentation. Ce type de présence des acteurs au début de la pièce tend, selon une convention héritée aussi bien de la performance que du théâtre d’intervention, à atténuer d’emblée la distance propre à la représentation: il est ainsi possible de voir dans les personnes sur scène à la fois des acteurs opérant en leur nom et les révolutionnaires russes du texte de Camus.
Mais lorsque les acteurs commencent à jouer, leur jeu très théâtralisé contraste fortement avec le «naturalisme» de leurs échanges initiaux. On pourrait cette fois qualifier ce jeu de réaliste, au sens où les signes produits sont nettement assumés comme symboles, c’est-à-dire pouvant et devant être déchiffrés selon divers codes et conventions prédéfinies. On pourrait aussi le qualifier de brut, dans la mesure où^il ne semble viser aucun effet esthétique. Il s’autorise des embardées vers le tragique ou vers le comique, notamment par des actions absurdes ou exagérées (se rouler au sol de rire, planter des clous pendant de longues minutes…). La mise en scène de Morin semble ainsi avoir pris le parti de ne jamais rien s’interdire: c’est ainsi que l’on verra les acteurs passer tranquillement d’un modèle de littéralité textuelle à des modes de jeu cartoonesques, voire carrément hollywoodiens ou franchouillards. Des interpellations directes du public cohabitent avec des scènes de «quatrième mur» proprement stanislavskiennes. Il est cependant notable que tous ces registres, y compris les plus distanciés, sont à chaque fois assumés pleinement; leur alternance continue révèle aussi bien les multiples articulations de la représentation qu’elle permet de dérouler rigoureusement la fable et ses enjeux.
Le texte de Camus expose un cas de conscience propre à la philosophie de l’action : répondre à la violence injuste de l’État tyrannique par la violence juste de l’action révolutionnaire. Le moment du passage à l’acte est l’occasion d’énoncer de nouveau ce vieux paradoxe: comment faire triompher la justice sans être injuste soi-même? Comment se justifier de la violence et de la mort? Dans la pièce de Camus, toutes les positions (idéaliste, radicale, pragmatique…) sont clairement distribuées entre les personnages. Or la mise en scène de Gwénaël Morin brouille ces assignations en en faisant apparaître le caractère contingent, c’est-à-dire la dimension performée de chaque position: ainsi l’adhésion stricte du personnage Kaliayev à sa fonction-idéaliste est malmenée par les clowneries de l’acteur Guillaume Bailliart; la fonction-amoureuse du personnage de Dora est atomisée par l’interprétation sans affects de Stéphanie Béghain, etc. Tous ces procédés de distanciation n’ont pas comme chez Brecht la fonction de défaire l’illusion, d’empêcher l’identification, de révéler l’artifice, d’afficher un discours ou de faire apparaître une structure socio-politique. Ils servent au contraire à diffracter le didactisme de la pièce en un nuage de significations possibles où plus rien ne semble joué d’avance.
Pour enfoncer ce clou, la mise en scène ménage plusieurs ruptures dramaturgiques fortes. La première survient lorsque Mélanie Bourgeois prend le prétexte d’un manque de rigueur des autres acteurs pour se lancer dans une interminable et hilarante crise de nerfs. À ce moment, la fable du texte s’efface au profit de celle des rapports entre les acteurs. Mais un doute peut alors s’installer: l’actrice s’adresse tantôt aux acteurs, tantôt aux personnages, faisant référence à la fois à la situation réelle et à celle de la fiction, si bien qu’il devient difficile de savoir si c’est l’acteur, le personnage, ou l’acteur en tant qu’il joue le personnage qui s’adresse au public. Cette coexistence des modes d’énonciation semble être le point d’orgue du dispositif mis en oeuvre par Gwénaël Morin. Il déploie différents degrés de responsabilité de parole : l’acteur et/ou le personnage est animateur et/ou auteur et/ou responsable de la parole de l’auteur et/ou du metteur en scène et/ou des artistes sur scène.
Une autre rupture majeure a lieu à l’occasion d’un changement du lieu de l’action. Pour mieux évincer la réflexion moraliste de Camus, Gwénaël Morin substitue à l’acte IV du texte une scène qui en inverse radicalement les présupposés. Après avoir réussi l’attentat, l’arrestation du personnage de Kaliayev est l’occasion d’une ouverture spectaculaire du fond de scène, ouverture d’autant plus impressionnante qu’elle prolonge la continuité scène/salle vers un espace encombré d’effigies de soldats en taille réelle, tenant le public en joue. Pendant qu’une actrice joue un air au pipeau et qu’un autre s’acharne sur une batterie, on distribue des oranges au public. Un usage possible de ces oranges apparaît quand certains spectateurs entreprennent de viser les effigies de carton comme pour une joyeuse séance de chamboule-tout. À ce moment, chaque spectateur doit alors prendre son parti : participer au jeu de massacre, que ce soit pour le simple plaisir de jeter des oranges, pour s’attaquer symboliquement au Pouvoir ou pour s’inscrire dans la fiction des Justes (dans ce cas, orange égale bombe); ou bien refuser l’orange, la passer à son voisin, voire la manger. Si on peut être effrayé par la forme participative que prend le spectacle alors qu’un déluge d’oranges s’abat sur les soldats de carton, il faut reconnaître qu’est laissé à chaque spectateur le choix de la modalité de sa (non-)participation. Ce n’est qu’ainsi que cette scène échappe à son écueil démagogique, et marque bien plutôt l’aboutissement de la logique de déconstruction entreprise depuis le début de la pièce: où le spectateur devient acteur (et personnage) de la pièce, mais à sa guise et depuis sa place.
Le dernier acte verra le retour apparent à une théâtralité classique, mais dans un espace entièrement ouvert et dépouillé de tous ses signes. Cet acte culmine dans l’ascension des gradins qu’opère Stéphanie Béghain en s’appuyant sur certains spectateurs, marquant une dernière fois le caractère à la fois commun et asymétrique de l’assemblée théâtrale. Tout le récit de l’exécution de Kaliayev est ainsi chuchoté littéralement par-dessus la tête des spectateurs, produisant un effet d’inclusion du public au coeur du récit, mais cette fois en tant que pur décor, masse impuissante au souffle coupé. Cette dernière configuration conclut toute la série de métamorphoses de la relation acteurs/spectateurs, au cours de laquelle le spectateur a été amené à chaque étape à réévaluer son rapport au spectacle, entre identification et analyse critique du dispositif.
Car au-delà de l’actualité du sujet, c’est bien de la situation politique en jeu dans le dispositif théâtral qu’il est question. Morin revisite avec virtuosité différents codes historiques du théâtre. En orchestrant la coexistence de ces registres, le spectacle se joue continuellement du trouble qui provient déjà de chacune de ces conventions, si bien que la relation entre acteurs mais surtout celle entre acteurs et spectateurs reste toujours équivoque. En jouant de l’homologie entre une action théâtrale et une action révolutionnaire, en opérant sans cesse des glissements furtifs entre ironie et littéralité, Les Justes reposent la question du passage à l’acte d’une manière qui n’est plus seulement morale (ainsi que nous y invitait le texte de Camus), mais pratique: plutôt que d’engager le spectateur à se positionner face à une situation idéal-typique, le spectacle le renvoie à l’ici et maintenant de sa place au sein de la représentation ; à une interrogation binaire sur les justifications, les moyens et les limites de l’action politique, il substitue la possibilité d’interprétations incomplètes et paradoxales qui, in fine, nous mlaissent la tâche de produire chacun notre justification – celle de notre présence au théâtre ce jour-là.
1 - Depuis 2006, tous lestitres des spectacles de Gwénaël Morin prennent la forme suivante: Philoctèted’après Philoctète de Sophocle, Lorenzacciod’après Lorenzaccio de Musset, etc.
2 - Cette dimension est aussi patente dans le projet en cours du Théâtre Permanent, puisque les pièces qui y sont créées comptent parmi les plus célèbres du patrimoine théâtral occidental: Lorenzaccio, Tartuffe...