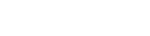93 par Barbara Manzetti
Bonjour.
Tu imagines ta ville étanche. Qui étale camions canalisations caoutchoucs carrelages caves chariots chapeaux chiots charcuteries cinémas clôtures et autres télévisions. Au nombre de pages ça fait un roman immense. L’annuaire blanc et le jaune. Sorte d’interrupteur sur minuterie. Tout le temps là à tous les étages. Si nous ne nous obstinons pas à chercher le centre. C’est comme si la vie n’en avait pas. De toute façon. Le centre a été décentré. C’est un truc rayé. Fait de lignes. Ta vie. La mienne. La sienne. La leur. Ligne après ligne. Et ce déroulement constant dans lequel nous nous regardons. Les uns. Les autres. Je constate que. Tiens tes cheveux ont poussé depuis la dernière fois. Tes cheveux poussent plus vite que les miens. On dirait. La chance. Que tu as. Puis en regardant ce qui semble être le centre de nos existences maintenant. Cette pièce sans fenêtres où il fait plus jour que dehors. Tu peux respirer l’air qui te traverse et le son que ça fait. C’est magique. Ta voix. La voix d’une rangée de peupliers. Des conversations. Des conversations d’arbres. Vies à cheveux qui poussent. Histoire de prendre le vent. C’est toujours ça de pris. Dans le vent. Leur choeur qui se tait en agitant les mains. Qui produit du silence. Qui enfouit la rumeur des voitures-peintres. Voitures-paysagistes. Motos-pédiatres. Vélos-pédicures. Carrosses-peintres illustrateurs. Bus-pépiniéristes camions-plombiers et avions-poissonniers. Tu flaires. Fier de ton odorat qui résiste à l’épreuve urbaine. Ça va aussi vite que les choses qui nous échappent. Spectacles spectaculaires. Tapis tapis. Tailleurs taillés. Tapissiers décollés. Taxis partis. Ça a le goût de ce qui est de saison et qui nous revient. La saveur ambiguë d’un retour annuel au pays. Par exemple. Et d’autres bonheurs aussi que nous pouvons reprendre. Tu reprends les toits de ta ville aperçus. Reconnus instantanément. Comme à chaque fois une demie-image bouleverse ton coeur. Neuf Trois. Ta ville emboutie dans le département embouti dans la nation tricolore. Bleu. C’est le micro t-shirt japonais réduit en cube à réhydrater en arrivant à destination. Un verre d’eau nous rhabille à des milliers de kilomètres de la maison. Blanc. En examinant le feu de camp nous apprenons le temps qui nous sépare des fugitifs. 20 minutes si c’est encore chaud. Rouge. Gros plan sur nous alertés par la présence de fumée. Faisant image de nous-mêmes immobilisés l’index dans les cendres chaudes. Faisant image de nous-mêmes rassemblés avec cette chorale d’arbres à l’intérieur de la maison. Nos actions et pensées constamment entourées par un courant d’automobiles. Dans la zone arborée encerclée de voitures. D’arrondissements. Ils disent. La nuit elles deviennent ces machines aux yeux blancs qui viennent. Attirées par l’éclat de nos yeux. Ce flot nuit et jour ne sera jamais une rivière. Pour nous. Jamais un son toujours un bruit. Pour nous. Jamais une rumeur toujours ce bruit. Maintenant moi. Les talons sortis libérés des baskets rosissent. Il faut croire que l’eau que je bois n’atteindra jamais mes orteils. Ça me fait ces pieds de reptile. Dans le miroir. Dans nos oreilles. Parce que. La constance du bruit nous dessine un cercle autour du crâne et ce n’est pas drôle. Non. C’est d’une violence trop banale pour être relevée. Les yeux remontent là-haut jusqu’à la ligne d’horizon. Voilà un dégagement. Une demie seconde de soulagement. Dans cet équilibre que nous percevons. Dans le ciel. Un instant que nous percevons plus ample dans le corps du temps. Ce qu’ils appellent. Ils disent. Avec cette expression convenue. Ah. Je vois. C’est un peu comme. Sans connaître la suite. Voyez-vous. Nous y passerions les heures et les journées que ce ne serait pas assez. Mais ça y est. C’est une plage. Une maison tournée vers la mer. Ça y est nous ne cessons d’arriver de nous y installer comme il faut. Voilà les assises à l’ombre. Voilà les portes les volets lavande. Enfin voilà les emplacement prévus pour les amis. Partout abondance de tissus à motifs floraux désuets. Jusqu’aux tasses. Aux soucoupes. C’est à la lisière d’une forêt. Et nous sommes distraits par l’obscurité qui avale nos réalités. Nous nous absentons mais notre peau reste en place. Ça arrive tout le temps. Nos épidermes qui se côtoient durant les trajets en bus. Alors prenons pour jardin 30 mètres de cette cotonnade verte. La longueur excédante s’enroule en jupe autour des hanches. C’est un ensemble très élégant. Voyez-vous. Comme la nature. Ou la forêt si vous voulez. Nous passons vite. Dans cette parenthèse qui pourrait faire un sacré bon ménage là-dedans. Sans semer d’indices. En plus. Vous êtes en pyjama devant une rangée de peupliers. Arbres. Gesticulants. Verts. Vous devez tout imaginer car ils ont posé des déviations. Et des déviations. Puis de temps à autre une autre déviation. Tellement de déviations que vous en avez tapissé votre chambre et le devant de la maison. C’est à ce moment là que de fatigue l’enfant pose sa bouche sur votre épaule. La chance que vous avez. C’est une plage. Ce geste sur vous. La chance de votre vie. Une maison tournée vers la mer. De toute façon on n’a jamais vu de maison tournant le dos à la mer. C’est la forêt après le grand rangement. Sans les petites mains vertes des feuilles. Les ravissantes petites paumes d’argent. C’est la forêt sans gesticulations. La foule sans enfants. Quand vous rentrez le soir vous ramenez un miroir. Chez vous. À la fin d’une journée. Comme une autre. Qui se termine elle aussi avec un miroir dans les bras. Et ce visage qui est le notre et qui nous suit partout. On ne l’a jamais vu nous tourner le dos. Ce n’est pas un proverbe irlandais. Le lendemain de cette conversation il se réveille avec un voile noir. Dans la bouche. Cette chose qui est la tristesse s’est déplacée du visage. À la bouche. Un tissu de sentiments qu’il est enfin possible de perdre. Par la bouche. Comme une banalité. C’est ce qui se passe ici. Nous ne vivons pas ensemble. Ce sont des brefs aménagements dans un livre. Ta vie. La mienne. La sienne. La leur. Et ce déroulement constant dans lequel nous nous regardons.
Barbara Manzetti, Une performance en forme de livre,
Les Laboratoires d’Aubervilliers, septembre 2011.
Texte publié dans le Journal des Laboratoires de mai-août 2012