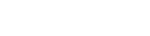Béatrice Rettig
Nous avons appelé cette soirée D’un mouvement l’autre pour parler de la façon dont chaque mouvement réunit des composantes multiples et n’est jamais uniforme; ou de quelle façon un mouvement se créant autour d’une question spécifique est toujours traversé d’autres questions. D’un mouvement l’autre, cela veut dire du mouvement des sans-papiers au mouvement des femmes, à celui des universités peut-être et ainsi de suite. Cette rencontre vient à la suite de rencontres où nous étions militants, sans-papiers, étudiants, enseignants, etc. et où l’on était prédisposé à nous poser la question de la possibilité d’un mouvement de cette façon-là, au travers de situations, de compétences, de statuts différents. En étant invitées à développer un projet d’œuvres in progress qui nous relieraient, nous nous sommes rencontrées simplement dans l’idée de réfléchir ensemble à partir de ces situations, ces compétences, ces statuts. Notre projet a consisté en des rencontres où telle ou telle question pourrait être développée (la question du travail, l’histoire de l’immigration, l’actualité politique liée aux sans-papiers) et où de nouvelles questions pourraient émerger. D’un mouvement l’autre, c’est donc le mouvement qui alimente le tissage de nos réflexions et de nos pratiques. C’est peut-être aussi celui de parcours de vie. Comme on pourrait le dire du film (1) de Dounia Bovet-Wolteche que nous regarderons tout à l’heure, c’est le mouvement à plusieurs voix du film qui ne se donne pas de fin, mais permet de reparcourir une histoire, d’y porter un regard capable d’y actualiser ce qui importerait pour nous maintenant.
C’est aussi un titre qui fait écho à d’autres actes écrits et diffusés par des étudiants au printemps dernier (Commencer un mouvement, qu’est-ce qu’un mouvement?). Les étudiants y explicitaient certaines de leurs revendications et s’interrogeaient sur les formes de mobilisation appropriées à leurs revendications. Parmi ces revendications, figurait en premier lieu celle de la possibilité de vivre un mouvement de façon pleine et intègre où la politique n’est pas une activité professionnelle, mais une découverte du potentiel d’actions collectives d’un mouvement, de la prise de paroles, de sa propre capacité à agir, à se réaliser. Dans le premier tract, Commencer un mouvement, diffusé en mars dernier, ils avaient écrit: «Nous sommes nombreux à avoir vécu l’expérience des fins de mouvement, où la douleur de la “reprise” ne rendait que plus pressant l’impératif de continuer, et ce en dépit des amères victoires stratégiques, syndicales ou parlementaires. Mais grâce à cette expérience, semble précisément s’ouvrir une perspective nouvelle qui consiste à commencer un mouvement comme si l’on était déjà en train de le continuer (c’est-à-dire s’affranchir de ses objectifs limités, à court terme, pour rejoindre un peu plus vite son horizon réel); mais c’est aussi continuer un mouvement comme on l’avait commencé, ce qui signifie se placer dans la posture, critique et réflexive, d’un engagement lucide tout en gardant cette forme qu’est le mouvement, où les singularités diverses parviennent à tenir ensemble, où du commun se dégage, où des liens se créent.»
En juin, dans le deuxième tract –la fin de la grève des universités–, ils reprenaient la même question en disant: «Les mouvements ne sont pas, comme on voudrait nous le faire croire, des combats apolitiques motivés par un calcul d’intérêt, qui nous mèneraient, après des manœuvres stratégiques et d’habiles négociations, à un profit, dans des situations qui nous concernent en particulier (en tant qu’étudiant, enseignant, travailleur de telle entreprise, etc.). En pensant les choses de cette manière, on reproduit exactement le schéma dominant: celui d’un individu narcissique, isolé, séparé, qui travaille et qui consomme, qui évalue soigneusement ses intérêts “privés” et laisse la politique aux professionnels dont c’est le métier. Mais il faut vivre un mouvement social pour savoir que tout cela n’est que du discours superficiel. Il faut le vivre pour mesurer à quel point s’y créent des lieux politiques, où se pratiquent la démocratie, la création, la rencontre, l’enthousiasme. Derrière l’aspect terne des mots d’ordre et des argumentaires, il y a la richesse passionnante d’une expérience collective. Et derrière cette expérience il y a une possibilité politique, une possibilité d’émancipation autrement plus profonde que ce que font les politiciens quand ils accèdent au pouvoir, à savoir essentiellement de la gestion.»
Pour parler de cette idée du passage d’un mouvement à l’autre, ou d’un mouvement qui en appelle un autre, de quelle façon un mouvement n’est jamais uniforme, on pourrait aussi parler de la façon dont, par exemple, est présente la question des femmes à l’intérieur des actions du 9e Collectif dont Bahija Benkouka est militante. Cette question n’était jamais abordée comme celle d’une minorité à l’intérieur d’un groupe minoritaire (les femmes sans-papiers parmi les sans-papiers), comme une caractéristique spécifique qui sépare encore à l’intérieur d’un groupe déjà séparé, mais comme une question transversale au contraire qui traverse toute la société, comme toutes les autres questions sur lesquelles le 9e Collectif travaille et au travers desquelles le mouvement des sans-papiers s’exprime en fonction de l’actualité politique (le travail, la rétention, la santé).
Qu’il s’agisse des sans-papiers, des femmes, du travail, on ne se trouve bien sûr pas en face de questions ou de catégories de questions dont on aurait voulu spontanément parler. Ce sont des questions et des catégories de questions qui nous sont imposées par cette actualité et à quoi répondent des identifications qui ne sont bien sûr pas stables selon que l’on est une femme sans-papiers, un travailleur sans-papiers, etc. –alors qu’on est toujours à la fois plus ou moins que cela–, mais, dans tous les cas, par quoi on ne s’est pas défini soi-même.
À ce sujet, le travail du 9e Collectif consiste notamment en grande partie à agir relativement à ces questions, donc la question du travail, la question des femmes, etc., pour obtenir des régularisations, et à mener des actions, notamment médiatiques, mais, au-delà, à donner la possibilité d’agir en intégrité, de s’affirmer dans la dignité de cette intégrité, de se découvrir une capacité de prise de parole collective et, de là, à rendre lisible une relation conflictuelle entre cette affirmation et les conditions de vie, de travail qui sont imposées aux sans-papiers.
La restitution du parcours de nos rencontres et de nos réflexions, dont un extrait paraîtra dans Le Journal des Laboratoires, se fera aussi avec un site présentant les transcriptions de nos conversations, de nos rencontres et d’autres développements à partir de ces rencontres.
Ce soir, nous avons aussi invité d’autres interlocuteurs de ces rencontres: Éric Lecerf, Marion Baruch et Myriam Rambach (Bordercartograph), Dounia Bovet-Wolteche avec ce film qu’elle nous présentera ensuite. J’aurais voulu proposer, Bahija, que vous puissiez parler du 9e Collectif et du type d’action mené sur ces questions: le travail, les femmes.
Bahija Benkouka
Ce Collectif a été créé en 1999, à la suite de l’afflux des déboutés de la circulaire Chevènement. Quand la gauche est arrivée au pouvoir en 1997, elle a mis en place une circulaire pour dire qu’elle allait s’attaquer au problème posé sous la droite (Debré et Juppé). Qui dit circulaire, dit arbitraire. Les régularisations se sont faites de manière arbitraire. 150 000 dossiers ont été déposés. 63 000 ont été régularisés. La moitié a été déboutée. Des sans- papiers déboutés de cette circulaire ont décidé de sortir de l’ombre, de mettre en place une structure et de s’organiser pour pouvoir revendiquer la régularisation et une vie digne. Ce collectif a donc été créé. Sa spécificité est qu’il regroupe vingt-cinq nationalités. Il est ouvert à toutes les nationalités, toutes situations confondues (étudiants, déboutés de l’asile, familles, personnes qui demandent une carte de séjour pour soins médicaux, etc.). Une autre spécificité est qu’il s’agit d’un collectif autonome. Ce sont les sans-papiers qui portent les revendications et les soutiens viennent en appui. Notre lutte s’articule autour de deux axes, juridique et politique.
Concernant l’axe juridique, il y a des permanences juridiques pour recevoir les sans-papiers, pour constituer les dossiers.
L’axe politique consiste à mener des actions pour créer un rapport de force, pour sensibiliser l’opinion publique et pour exiger la régularisation de tous les sans-papiers. Cela consiste à mener des actions dans des permanences politiques, par exemple celle du ministre de l’Intérieur, de manifester devant des institutions où s’exercent les discriminations (préfecture, ministère de l’Intérieur, ministère de la Santé, etc.), de faire des interpellations lors de meetings politiques pendant les campagnes électorales, d’organiser des débats, des réunions d’information sur la rétention, etc. Cela consiste aussi à occuper des ONG, telles que l’UNICEF par rapport à la question des familles et de la protection des enfants. En effet, l’UNICEF est une organisation internationalement reconnue pour la défense du droit des enfants. Des sans-papiers, des familles, se sont réfugiés à l’UNICEF pour exiger la protection de leurs enfants. On trouve en effet souvent des familles qui sont séparées, déchirées et les enfants sont victimes de ces séparations. C’est une présentation brève. Des sans-papiers sont présents ici. Ils appartiennent au 9e Collectif. Ils peuvent compléter mon propos si j’ai oublié certains points.
Le combat des sans-papiers ne doit pas être mené de manière séparée des autres combats. La question des sans-papiers, fondamentale, soulève tous les problèmes de la société. Par conséquent, elle touche tous les combats (l’accès à un logement décent, le combat pour de meilleures conditions de travail, l’accès aux soins, etc.). Il est important que ce combat ne soit pas mené de manière isolée parce que l’isolement est le seul ennemi des sans-papiers. Ainsi, sur la question du logement, nous essayons de mettre en place des actions conjointement avec d’autres mouvements tels que les sans-logis. Sur l’accès aux soins, nous avons essayé de mener des actions avec des associations qui se préoccupent de cette question, comme Act Up. Nous avons mis en place des die-in devant le ministère de l’Intérieur du fait des attaques portées à l’aide médicale d’État qui est le seul outil, le seul instrument, minime, pour permettre aux sans-papiers d’avoir accès aux soins. Nous avons mené aussi des actions avec les étudiants, comme l’interpellation au Musée de l’immigration de Besson et d’autres ministres qui y ont été invités. Concernant le travail, il faut dire que les sans-papiers sont en première ligne de la précarisation généralisée. Défendre leurs droits, c’est défendre les droits de tous les travailleurs. Par ce biais, on a mené des actions telles que l’occupation de la Fédération nationale du bâtiment parce que, majoritairement, les sans-papiers travaillent dans ce secteur. Ils sont surexploités. Il fallait donc dénoncer cela et exiger du patronat qu’il se prononce sur cette situation. Nous avons aussi interpellé les syndicats en 2007, à la Bourse du travail, pour leur demander de prendre en charge ces revendications. En tant que syndicats, ils doivent être en première ligne de la défense des droits des travailleurs et, plus particulièrement, des travailleurs sans-papiers. Nous essayons de construire une convergence des luttes avec d’autres mouvements.
J’essaierai de parler brièvement, pour laisser la parole aux autres sans-papiers qui sont présents, des questions sur lesquelles nous avons travaillé ces derniers mois. La première de ces questions est celle de la rétention. Fin 2007, des grèves ont eu lieu dans les centres de rétention. Nous avons essayé d’organiser des marches vers les centres de rétention pour essayer d’être solidaires avec les revendications des sans-papiers enfermés qui, du fait de la politique du chiffre, vivent dans le stress et l’angoisse parce qu’ils risquent l’expulsion. Nous avons travaillé aussi sur la question du travail et, plus particulièrement, sur les travailleurs isolés. Nous avons aussi abordé la question des femmes sans-papiers qui travaillent en général chez les personnes, dans les familles. Elles sont isolées, elles ne sont pas syndiquées. Elles n’ont pas la visibilité nécessaire pour exiger leurs droits.
Voilà, sommairement, les axes sur lesquels le 9e Collectif se mobilise. Je laisse la parole à Najed qui a participé à des actions de femmes.
Najed
Nous avons mené dernièrement quelques actions. La dernière a eu lieu au Haut Conseil à l’intégration. Nous avons mené encore une autre action chez Dati. Nous avons réalisé ces actions pour débloquer des dossiers et faire avancer la régularisation des autres sans-papiers dans le collectif. Nous allons continuer d’autres actions dans les mois prochains.
Bahija Benkouka
Nous avons aussi occupé l’Agence nationale des services à la personne, parce que c’est un lieu symbolique par rapport à cette problématique, et le secrétariat d’État chargé de la Solidarité. Un accord a en effet été signé entre le ministère de l’Immigration et l’Agence nationale des services à la personne pour que les femmes qui viennent par regroupement familial soient orientées vers les secteurs des services à la personne alors que des milliers de femmes sur le territoire français sont exclues de leurs droits et exploitées. Il s’agissait donc de dénoncer ces contradictions et de mettre le gouvernement en face de ses responsabilités et de ses contradictions.
Public
Je voudrais rajouter un mot. Je me rappelle très bien les actions de femmes qui avaient été menées. Il y avait eu des réunions préparatoires de femmes. Chacune avait écrit son slogan sur des pancartes, en rapport à ce qu’elle avait vécu.
Bahija Benkouka
Il était aussi intéressant de créer des espaces de discussion entre femmes. Être femme sans-papiers est vraiment un problème spécifique. Les femmes subissent une double discrimination du fait qu’elles sont femmes et qu’elles sont sans-papiers. Il était donc important de créer un espace de discussion entre ces femmes. Nous avons transcrit les discussions. C’est très intéressant. Des choses n’étaient pas dites en assemblée générale quand hommes et femmes étaient présents. Ces choses ont pu être dites dans des espaces de discussion réservés aux femmes.
Yvane Chapuis
Vous avez dit avoir essayé de travailler autour du problème des femmes isolées, qui travaillent chez les particuliers. Vous avez évoqué l’idée d’un syndicat, me semble-t-il, ou de les syndiquer. Où en êtes-vous de cette démarche? Ce syndicat existe-t-il aujourd’hui?
Bahija Benkouka
En fait, nous avons interpellé les syndicats pour qu’ils prennent en charge les revendications des sans-papiers. Ce sont les travailleurs les plus exploités et, donc, il est important d’interpeller les syndicats pour qu’ils prennent leurs responsabilités et défendent les sans-papiers.
Public
Quelle a été la réponse des syndicats?
Bahija Benkouka
En 2007, il y a eu une expulsion. Nous n’avons donc pas pu vraiment négocier avec eux. Puis des mouvements de grève ont été déclenchés en avril 2008. Il s’agissait de piquets de grève de travailleurs sans-papiers au sein des entreprises pour exiger une régularisation. Mais il y avait un problème. C’était courageux de la part de ces travailleurs sans-papiers de sortir de l’ombre et de revendiquer leurs droits sur leur lieu de travail. C’est une expérience assez intéressante. Mais ces grèves ne concernaient qu’un groupe de personnes présentes sur un site de travail, pas les gens qui travaillent au noir ou de manière isolée, qui ne sont pas syndiqués. Le cas le plus intéressant à cet égard est celui des femmes sans-papiers qui travaillent à domicile. Elles sont isolées et ne peuvent pas porter leurs revendications sur la place publique, – c’est délicat quand on travaille dans la famille d’un médecin ou d’un avocat. Il faut rappeler que la majorité de ces femmes travaillent dans des quartiers bourgeois, dans les VIIe ou XVIe arrondissements, à Neuilly, même chez des juges, chez des gens qui mettent en place ces lois discriminatoires et répressives. Les travailleurs isolés étaient exclus de ces mouvements parce qu’il est difficile de les organiser. Il fallait donc interpeller les syndicats pour qu’ils prennent en charge aussi les revendications de ces personnes non syndiquées isolées. Donc, d’une part, un mouvement s’est déclenché et il était intéressant, mais tout le monde n’était pas inclus dans ces mouvements. D’autre part, les régularisations qu’ont pu obtenir ces grévistes étaient précaires. Le renouvellement n’était pas acquis. Il s’agissait de récépissés. C’était un statut salarié au bon vouloir du patron. Il y a des critiques à formuler sur tout cela.
Yvane Chapuis
Vous avez mentionné l’occupation de l’UNICEF. Quelle a été la réponse de l’UNICEF par rapport à cette occupation?
Bahija Benkouka
C’était en mars 2005. Des familles et des célibataires se sont réfugiés à l’UNICEF dans le IXe arrondissement pour les interpeller sur la situation des familles qui sont séparées, des enfants qui sont aussi arrêtés et mis dans les centres de rétention avec leur famille. Il faut rappeler qu’aujourd’hui il y a des enfants qui sont enfermés dans des centres de rétention. C’est scandaleux dans un pays signataire de plusieurs conventions internationales censées protéger les enfants. L’UNICEF nous a répondu qu’il s’occupe des enfants dans les pays du tiers monde et qu’ici, ce n’était pas de leur ressort. C’était à peu près leur réponse. Nous sommes resté quarante-sept jours. Après dix-sept jours, douze familles ont entamé une grève de la faim, ce qui est une action extrême de lutte. Ce type d’action peut se déclencher à cause de la politique répressive. Plus la politique et son application deviennent restrictives, plus les sans-papiers ont recours à des actions extrêmes de lutte telles que la grève de la faim. Au bout de quarante-sept jours, l’UNICEF a expulsé les sans-papiers. Nous nous sommes réfugiés alors à la Bourse du travail. Il était difficile de faire que les médias en parlent. Les médias attendent un moment spectaculaire pour venir sur place et en parler. Au bout de quarante-huit jours, les grévistes de la faim étaient extrêmement fatigués. C’était devenu très dangereux pour leur santé. Toute grève de la faim est dangereuse et a des conséquences graves sur la santé des personnes. Nous avons vu alors affluer les médias. C’est devenu surmédiatisé. Le gouvernement a cédé. Villepin, alors ministre de l’Intérieur, a cédé. Il a régularisé sans critères les douze grévistes de la faim. C’était quand même une petite victoire parce que la régularisation était collective. Ce n’était pas au cas par cas. Il a examiné tous les autres dossiers selon les mêmes critères mais après soixante-dix jours de lutte, dans des conditions difficiles. La situation des grévistes était très éprouvante. Il y avait des malaises. Malgré cela, le gouvernement est resté muet. Il fallait vraiment que toutes les associations viennent soutenir cette action.
Public
Quelles sont les conditions de régularisation aujourd’hui? Actuellement, quelles chances ont les gens d’être régularisés? Avec quels moyens et dans quelles conditions?
Bahija Benkouka
Les régularisations se font au compte-gouttes. De plus en plus, les préfectures ferment les portes. Il y a donc de plus en plus d’obligations à quitter le territoire, des arrêtés de reconduite. La politique du chiffre est mise en place. Aujourd’hui, les sans-papiers –qui sont des personnes– se trouvent réduits à des chiffres. Chaque année, on dit que l’on va expulser 28 000, 24 000... C’est vraiment scandaleux de voir des personnes réduites à des chiffres. Cette politique inhumaine a des conséquences meurtrières. On a vu des gens qui, pour fuir la police, se sont défenestrés ou se sont noyés, comme Baba Traoré à Joinville-le-Pont ou Chulan Liu à Belleville. Face à ce gouvernement, il faut toujours créer un rapport de force, il faut se mobiliser, il faut réfléchir à la manière de le faire, comment le faire et construire ce rapport de force, d’où l’intérêt de faire converger la lutte des sans-papiers avec d’autres luttes. Vraiment, il faut le rappeler: l’isolement est le seul ennemi des sans-papiers. Il faut créer des réseaux de solidarité. C’est grâce à ces réseaux de solidarité que ces luttes peuvent être gagnées.
Public
Il faut un rapport de force. J’appartiens au 9e Collectif. J’étais sans-papier. Comme cela a été dit, on s’est réfugié en 2007 à la Bourse du travail, à la station Château d’Eau. On est resté à peu près trois mois. On a été mis à la porte. On a passé trois nuits devant la porte. On a ramené des tentes en attendant qu’on nous rende nos affaires. Les syndicats nous ont défendus. Ils ont défendu les travailleurs, avec ou sans papiers. Après l’occupation de la Bourse du travail, j’ai eu mes papiers grâce à ce rapport de force, comme l’a expliqué Mme Benkouka. L’actuel président de la République, Nicolas Sarkozy, était au ministère de l’Intérieur. On a alors occupé le conseil général des Hauts-de-Seine, à Nanterre. C’est là que j’ai eu mes papiers. Il faut un rapport de force pour obtenir quelque chose.
Public
J’appartiens au Comité de vigilance d’Aubervilliers pour les sans-papiers. Il s’est créé en 2006 quand nous nous sommes aperçus que beaucoup de familles d’Aubervilliers étaient parties en préfecture à la suite de la circulaire. Elles y sont allées seules. Elles se retrouvaient devant dix guichets différents. D’un guichet à l’autre, on ne leur demandait pas les mêmes papiers. On en acceptait à certains guichets et pas à d’autres. Nous avons donc commencé des accompagnements: élus, syndicalistes, professeurs, voisins... La population s’est mise à accompagner. Et, fin juillet, il y a eu des parrainages. Sur la ville, on a commencé les parrainages républicains de tous les enfants. Il y en a eu plus de cent cinquante. Il faut savoir qu’il y a eu trois cents dossiers déposés en un mois et demi à Aubervilliers. Fin août-début septembre, et fin octobre, il y a eu trente et une régularisations sur trois cents. Après, il y a eu deux cents arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière (APRF). En un mois et demi, il a donc fallu travailler jusqu’à minuit et monter les APRF. Nous ne connaissions pas grand-chose. Nous nous sommes formés sur le tas. On prenait les voitures et nous prenions la direction du tribunal administratif de Cergy. Quand ils nous voyaient arriver avec des dossiers épais comme ça, ils disaient: «C’est Aubervilliers qui arrive.» Il y a eu cent soixante-quinze passages au tribunal administratif de Cergy en juin 2007. Nous existons toujours et nous nous réunissons régulièrement, toutes les semaines, à la Bourse d’Aubervilliers. Nous avons toujours du monde. Les anciens reviennent. Ceux qui ont eu les papiers nous interpellent dans la rue. Cela fait du bien. Ils viennent remonter le moral des autres. Cela nous remonte le moral pour continuer.
Je voulais intervenir sur les régularisations actuelles. On a tous remarqué qu’il y a toujours, selon la loi, la régularisation vie privée et familiale. Or il n’y en a pratiquement plus. Maintenant, ce sont quasiment toutes des régularisations par le travail, titre salarié, même s’il s’agit d’un couple qui est en France depuis dix ou onze ans, qui a des enfants scolarisés. On en est à écrire des lettres à la préfecture expliquant qu’une femme qui a quatre enfants va donner à garder ses enfants à une autre femme pour travailler à garder des enfants. On se retrouve dans cette situation-là puisqu’il faut un titre salarié. C’est une aberration. Concernant le titre salarié, si, au bout d’un an, il n’y a plus de travail, il n’y a plus de titre salarié puisqu’il est tributaire du travail. Il faut savoir que les titres salariés ne sont pas donnés de la même façon, par exemple, à la préfecture de Paris ou à celle de Bobigny. Il y a des exigences de cinq ans ou des exigences de sept ans. Les critères ne sont pas du tout les mêmes. En plus, pour une demande d’un titre salarié, tout le monde dit qu’il suffit d’un contrat de travail. Mais on oublie de dire qu’il y a des métiers privilégiés. Il y a les bons métiers et les autres. En dernier ressort, ce n’est pas la préfecture qui décide, mais un ensemble avec l’inspection du travail.
Et il y a de plus en plus d’OQTF (obligation de quitter le territoire français). Pourquoi? Cette procédure n’est pas orale, mais écrite. Il faut donc un avocat. Maintenant, une famille qui s’est décidée à aller en préfecture y va avec l’angoisse d’avoir une obligation de quitter le territoire français. Il lui faut donc 1 500 euros de côté pour payer un avocat. La procédure est écrite. Quand on se trouve au tribunal, tout a déjà été donné au juge. Et l’angoisse est toujours là.
Devant les préfectures, les files d’attente commencent à minuit. En ce moment, le matin, à la préfecture de Bobigny, la file d’attente commence à la porte 1 et va jusqu’à la bouche de métro – pour ceux qui connaissent les lieux. Parfois, il y a tellement de monde qu’à neuf heures et demie, on dit aux gens qui étaient là dès cinq heures du matin que l’on ne donne plus de tickets, qu’il n’y a plus de place pour ce jour-là.
Des réunions ont été organisées à Bobigny entre différents syndicats (syndicats de travailleurs, SNES, syndicats d’enseignants), des mouvements, des réseaux (Réseaux éducation sans frontières), le MRAP, la Ligue des droits de l’homme. Les partis politiques étaient là de façon non officielle. Nous étions là en tant que représentants du comité de la coordination 93. Ces réunions ont eu lieu parce que nous en avons eu assez d’avoir des réponses différentes quand nous sommes reçus en préfecture. Selon que c’est un collectif, un syndicat ou un réseau qui s’y rend, le préfet ne répond pas la même chose – ce qui fait qu’ils nous montent les uns contre les autres. C’est l’arbitraire le plus total. Nous voulons être reçus ensemble.
Public
J’appartiens au RESF Paris-Nord-Ouest, c’est-à-dire VIIIe, IXe, XVIIe et XVIIIe arrondissements. Ce qu’il y a de plus scandaleux, c’est que, d’une préfecture à l’autre, la loi n’est pas la même. J’entendais la personne d’Aubervilliers parler de titre salarié. On pourrait citer des dizaines de personnes avec une liste de qualifications longue comme un jour sans pain qui n’y arrivent pas. Dans le XVIIe arrondissement, un chantier a été occupé pendant quatorze mois sous les fenêtres du commissariat, juste derrière Truffaut, où vont les demandeurs. Au bout de quatorze mois, on a obtenu des titres salariés pour presque tous. Mais le sous-traitant qui les employait a fait faillite. Ils n’ont plus de travail, ils n’ont plus de logement. Nous avons donc les plus grandes craintes pour leur renouvellement. À Paris, ils bloquent au niveau des demandes. Nous devons donc déjà nous bagarrer pour que les gens puissent déposer une demande de régularisation. Ils sont refusés huit fois sur dix. Nous nous transformons donc en juriste. La situation nous oblige à faire des choses que nous n’avons pas choisi de faire. Je n’ai pas étudié le droit. Je n’ai pas vocation à passer dix heures par semaine à constituer des dossiers. Mais la situation nous contraint à faire de la sorte et nous empêche de nous en affranchir pour être inventifs et nous battre autrement. Ce dont on a besoin absolument, c’est d’élargir les bases de soutien, c’est de sortir du «eux et nous». Il n’y pas les sans-papiers et nous. Dans ce cas, les sans-papiers n’ont aucune chance et nous non plus par conséquent. On est ensemble. On est dans le même bateau. Les attaques contre le droit du travail visent d’abord les sans-papiers avant les salariés. Ce qui se passe avec les sans-papiers, à savoir l’arbitraire, des choses différentes d’un guichet à l’autre, d’une préfecture à l’autre, elles se passent partout au travail. Je travaille dans un secteur sinistré. Je sais que je fais partie des privilégiés puisque je suis encore fonctionnaire. Je travaille sur quatre établissements et j’ai des ordres contradictoires sur les quatre. C’est comme ça partout dans le travail. On expérimente toute la destruction du code du travail, de la santé et de tous les liens de solidarité d’abord avec les plus faibles, les sans-papiers, ensuite avec les autres et, en dernier, avec ceux qui sont le plus protégés parce qu’il n’y aura alors plus personne pour les défendre. La question des sans-papiers pose donc la question des rapports sociaux généraux, des rapports à l’argent, au droit, au travail, à la santé, à l’éducation pour l’ensemble de la population. Si on n’arrive pas à faire comprendre cela à l’ensemble de la population, on n’y arrivera pas. Si, pendant les manifestations, il y a vingt sans-papiers et dix soutiens derrière eux, on n’y arrivera pas. Il faut que les braves gens s’y mettent vraiment. Il faut absolument que l’on arrive à provoquer de nouveau ce qui s’est passé avec RESF. Il faut que l’on trouve un deuxième souffle avec tout le monde. Il faut une insurrection des braves gens. C’est de notre survie à nous tous dont il est question dans cette affaire.
Eric Lecerf
Je voudrais aborder deux points. Jusqu’aujourd’hui, quand on veut intéresser sur la situation des sans-papiers, il y a plusieurs moyens. Souvent, ces moyens nous amènent à l’échec. C’est vrai, on peut dire que ce qui est en train de se jouer avec les sans-papiers, ce sont des choses qui progressent petit à petit. Au risque de vous choquer, dans le monde du travail, on voit bien ce que l’on est en train de construire: d’ici dix ans, on n’aura plus besoin des sans-papiers, c’est-à-dire que la bourgeoisie qui exploite d’une manière éhontée des gens sans aucun droit n’aura plus besoin de sans-papiers. Foncièrement, on est en train de détricoter le droit du travail de telle façon que, bientôt, n’importe quel salarié aura les mêmes droits – les mêmes non-droits – qu’un sans-papiers.
On a parlé de convergence de lutte. En tant qu’universitaire, je viens de faire six mois de grève. Ce n’est pas si évident. Paradoxalement, on a très peu parlé de la question des sans-papiers. Finalement, où ai-je parlé de la question des sans-papiers? Où ai-je parlé de cette question-là d’une façon générale? C’était très peu dans ce qui nous mettait en grève. Je pense que c’était une erreur parce qu’il y a une relation, bien sûr.
Je n’ai pas démissionné de mes tâches administratives parce que, à Paris-8, à Saint-Denis, une de mes fonctions est de signer beaucoup de papiers pour des étudiants étrangers qui vont aujourd’hui tous les six mois à la préfecture, ce qui fait de moi un auxiliaire de la police. Je signe régulièrement des papiers attestant que les étu- diants sont assidus, etc. Et démissionner de mes tâches administratives, cela voulait dire que les étudiants étrangers n’avaient plus ce papier à donner. C’était les mettre tous en danger.
Dans l’université, la question des sans-papiers a été traitée de plusieurs manières. D’abord, sur un plan purement militant, la question de l’occupation a divisé énormément l’université. Il y a eu effectivement des militants qui ont soutenu les sans-papiers qui étaient là. Et, pour dire la vérité, une majorité de l’université (syndiqués, SNESUP, etc.) était tout à fait étrangère à la chose. Ils disaient: «Mais pourquoi chez nous?» Comme à la Bourse du travail. «Pourquoi chez nous? Pourquoi ne va-t-on pas chez les adversaires?» Au bout du compte, à la fin, bon gré mal gré, on est obligé de faire venir la police quand même.
Au moment de la grève des étudiants, il y a deux ans, le fait des sans-papiers a été plusieurs fois mis en avant dans les plateformes, mais, là encore, sur un mode purement militant. Je ne le révoque pas, mais, aujourd’hui, il est extrêmement difficile de parler de cette convergence sauf à tomber dans des choses très jolies mais qui ne sont pas vraies. Le grand tout du malheur humain, ce n’est pas vrai. Moi qui suis universitaire, je peux dire que ce n’est pas la même chose de lutter pour la défense du service public et de se battre pour les sans-papiers. Ce n’est pas immédiatement la même chose. Pourtant, c’est la même logique.
La vraie question est là. D’une part, il faut éviter les simplifications qui consistent à dire: « On est tous des sans-papiers. » Ce n’est pas vrai, je ne suis pas un sans-papiers. Même si, demain, mon université est privatisée – c’est ce qui se passera –, même si la recherche est plus compliquée, même si on est sous contrat avec l’État selon un managering local – tout ce contre quoi je fais grève –, je ne serai pas un sans-papiers. C’est donc ailleurs que je dois me mettre.
Il est clair que ce monde-là est celui qui fabrique les sans-papiers, celui qui a besoin de sans- papiers, pour nous directement. Hors des actions militantes que l’on peut avoir effectivement comme à RESF, hors du soutien que l’on a pour l’inscription des étudiants sans-papiers – dérogation que l’on obtient tout le temps –, il faut effectivement voir, dans une université comme la nôtre, qui est l’université de France qui accueille le plus d’étrangers, ce en quoi il y a aujourd’hui un devenir sans-papiers de la plupart de nos étudiants. On est confronté là à un vrai problème qui est, d’un côté, le fait de la judiciarisation, le fait qu’on «flique» tous les étudiants étrangers, le fait que cela devient de plus en plus difficile d’inscrire des étudiants étrangers, le fait qu’aujourd’hui, même dans une université de gauche, on a voté la convention qui est un vrai scandale. Aujourd’hui, pour qu’un étudiant étranger puisse venir dans une université, il faut d’abord qu’il passe par une base de données et par le consul de France, donc avec l’accord des universités locales. Notre université a accueilli pendant des années tous les étudiants qui venaient précisément parce qu’ils étaient pourchassés. Ils venaient de Grèce, d’Amérique latine, d’Iran, d’Algérie, de Bosnie. Cela a quand même été une des fonctions de l’université, une fonction universelle de l’université. C’est sur ces questions-là que, d’un seul coup, on arrive à faire une convergence.
Sur quoi se fait cette convergence? Elle ne se construit pas sur le fait que l’on serait tous des sans-papiers. Elle se construit sur le fait que l’on croit à l’universalité. Le savoir n’étant pas national, le savoir étant une convergence effectivement de pratiques, de déraisons, de traditions, l’université se situe sur un territoire qui n’est pas celui d’une nation. Dans ce cadre, nous avons écrit, dans le département de philosophie, une constitution des universités qui intègre le fait que les étudiants n’ont pas à produire de papiers justifiant leur nationalité à l’intérieur de l’université qui est, par essence, universelle – sauf à accepter d’être une école, mais pas une université au sens où la tradition de l’université a tou- jours été. On peut arriver à faire comprendre aux collègues et aux étudiants que des étudiants étrangers – même pas la question des étudiants sans-papiers –, qui n’ont pas une carte d’identité de la Communauté européenne, puissent s’inscrire en évitant tous les préambules et sans que l’on ait à vérifier leurs papiers. En tant que membre du conseil scientifique de mon université, je sais que cela veut dire que l’université, dès lors que ces étudiants sont inscrits, doit d’elle-même aller en préfecture, en son propre nom, pour demander la régularisation des étudiants – ce qui s’est fait d’ailleurs. L’université doit prendre en charge ses étudiants, qu’ils aient des papiers ou pas, parce qu’ils ont été acceptés sur un projet intellectuel, sur un projet de recherches. C’est la fonction de l’université. Dans ce cadre, on est dans une perspective dynamique par rapport à notre propre définition. Ce qui se joue ici, c’est de savoir si nous sommes encore une université ou pas. Cette question des étudiants étrangers nous concerne directement dans nos propres devenirs. Dans la sphère du travail, on pourrait évoquer d’autres convergences. D’une certaine façon, c’est aussi la question du salariat qui se joue chez nous et celle d’un devenir qui est le même que dans tout service public. Hors l’action militante que les uns ou les autres nous pouvons mener, l’université est un lieu vraiment important, mais il faut prendre le temps de penser ce que veut dire défendre la position, d’une manière générale, des étudiants sans tenir compte à aucun moment de leur inscription nationale. Cela ne résout pas du tout la question des sans-papiers. C’est un lieu où la question peut se traiter ainsi, sans être dans la fiction qui consiste à dire que nous som- mes tous les mêmes. Ce n’est pas vrai. J’étais un ouvrier français, je n’étais pas un ouvrier étranger. Ce qui était engagé, c’était la solidarité. Dans l’université, on peut trouver une position qui n’est pas tout à fait celle de la solidarité – ou la solidarité au sens le plus juridique du terme d’un engagement dans une même chose.
Public
Je voudrais partager avec vous un questionnement sur le plan professionnel. Je travaille pour une association qui s’occupe de la réinsertion socioprofessionnelle de jeunes dans le Val-d’Oise. Je parlerai de jeunes dont l’âge varie de dix-huit à vingt ans. Ils sont arrivés en France quand ils étaient très jeunes. J’ai en tête une jeune Cap-Verdienne arrivée en France à l’âge de quatre ans, prise en charge par une famille, bien scolarisée, sans problème. À dix-huit ans, elle a été déscolarisée entre 2006 et 2008. Elle n’a pas eu le droit d’avoir des papiers. Elle s’est retrouvée pendant deux ans avec un titre de séjour de trois mois renouvelable. En tant qu’association, nous avons le droit d’accueillir pendant un mois quelqu’un qui est sans-papier. Je reviendrai sur cette question. Pour les autres jeunes, nous pouvons les accueillir pendant une année après laquelle, normalement, ils partent avec un projet (une formation, un travail ou autre). Il se trouve qu’un récépissé de trois mois renouvelable sans autorisation de travail ne permet pas à ces jeunes d’avoir accès à une formation, comme cette jeune Cap-Verdienne qui voulait suivre une formation d’aide soignante et qui n’avait pas accès aux concours car, avec un récépissé de trois mois, elle était considérée comme sans-papiers. Elle n’avait pas la possibilité de suivre des stages parce que ceux-ci n’étaient pas rémunérés et pas reconnus par le CNASEA. Sans papiers, elle n’avait aucune possibilité de faire des stages. Elle se retrouve coincée. Les Missions locales nous envoient aussi des jeunes en nous disant: «Celui-ci, c’est un sans-papiers.» Or, légalement, nous ne pouvons pas les accueillir plus d’un mois. Que pouvons-nous faire en un mois? Nous n’avons pas de réseaux pour nous mettre en lien, mise à part la Cimade. Mais nous n’obtenons pas de rendez-vous. Il y a un jeune Marocain qui est arrivé en France à l’âge de quatorze ans pour des soins médicaux. Il a un excellent projet professionnel validé par la Mission locale. Mais il vient de recevoir une reconduite à la frontière. Il avait des récépissés de trois mois renouvelables. Maintenant qu’il a été appareillé (il est arrivé avec une surdité, il a été appareillé d’une oreille alors que la surdité est bilatérale), ils estiment qu’il peut retourner dans son pays. Or, entre quatorze et vingt ans, pendant six ans, il n’a pas vu ses parents. Il n’a pratiquement pas de liens familiaux avec ses parents biologiques, mais une famille le prend en charge ici.
Ma question est la suivante: que faire avec cette catégorie de jeunes? Nous ne pouvons pas faire appel aux syndicats. La Cimade ne répond pas vraiment à notre attente. En un mois, que pouvons-nous faire pour ces jeunes? Ils ont des projets professionnels qui ont été validés. Ce sont des jeunes qui «en veulent» vraiment et qui veulent vraiment construire leur avenir ici. Et ils ont les possibilités de le faire.
Bahija Benkouka
Selon la loi, un jeune qui est entré avant l’âge de treize ans, qui justifie une scolarisation de cinq ans, doit obtenir ses papiers à dix-huit ans. Mais c’est vrai qu’il y a le problème de ne pas pouvoir justifier de quelques années de scolarisation.
Public
La loi dit –mais la loi n’est pas souvent appliquée– qu’avec trois ans de prise en charge par l’ASE (aide sociale à l’enfance), tout jeune arrivant à dix-huit ans doit être régularisé sur simple déclaration. La loi, autrefois, disait qu’au bout d’un an de prise en charge par l’ASE, sur simple déclaration, on devenait français. Maintenant, la durée est de trois ans et les jeunes sont seulement régularisés, à condition que la direction de l’ASE en fasse la demande avant les dix-huit ans. Or, à l’ASE, il y a des consignes. Les éducateurs ne font pas ces déclarations et on se retrouve avec des jeunes majeurs isolés sans papiers. Il faut monter des délégations, il faut harceler les responsables de l’ASE, il faut travailler en réseau. Sur le 95, le Val-d’Oise, il y a aussi un réseau RESF qui est très actif. Il y a sûrement de nombreux autres réseaux. Il faut travailler en réseau avec tout le monde. Il faut absolument sortir du «ceux-là, je ne les aime pas». Il faut travailler avec le DAL, avec Droit devant!, avec la Cimade.
J’en profite pour rappeler une chose. Quand on n’a plus de logement, on n’a plus d’adresse, on n’a pas de renouvellement de papiers. À Paris, il y a des familles qui sont régularisées, qui obtiennent un logement en banlieue et qui ne sont plus régularisées sur l’autre département. Avoir des papiers, cela veut quelquefois dire se retrouver sans travail et à la rue; et, donc, au moment du renouvellement, sans renouvellement. Il faut absolument travailler avec les autres sur ces problèmes. La question du logement est encore plus difficile que la question des papiers parce que c’est une question qui divise. La question du logement, c’est: «Mais pourquoi me battre pour que celui-là ait un logement alors que moi, ça fait vingt ans que je demande un HLM et que je ne l’obtiens pas?» Il faut apprendre à mettre son ego dans la poche et à travailler avec tout le monde. Cela me semble fondamental.
Public
Je voulais aborder le point technique des jeunes qui ont des obligations à quitter le territoire. Il y a un moyen: le tribunal administratif. Il faut présenter le dossier au tribunal administratif en disant que l’administration s’est trompée et que le jeune a droit au séjour. Évidemment, pour un jeune majeur, c’est insurmontable. Il faut vraiment l’aider, soit demander l’aide juridictionnelle pour trouver un avocat, soit essayer de trouver un avocat pas trop cher. Quand on reçoit une obligation à quitter le territoire, il reste un mois. Il faut alors se remuer. Pour les jeunes, ce n’est pas facile parce que, souvent, ils mettent la tête sous l’aile en se disant qu’ils s’en sortiront. En fait, ils ont un mois pour constituer un dossier, prendre un avocat et saisir le tribunal administratif en disant que l’administration s’est trompée. Et il y en a beaucoup qui gagnent. Il faut un dossier conséquent.
Normalement, si on est arrivé avant treize ans, on a le droit automatiquement au séjour, mais ce n’est malheureusement pas toujours accordé. Il faut des preuves de présence et une continuité de scolarité. Certes, il y a certains jeunes qui quittent l’école, qui y reviennent. Pour ceux-là, on leur reprochera toujours qu’il manque une année d’école, mais ils peuvent se défendre au tribunal à condition de faire tout cela. Et, à dix-huit ans, on ne pense pas à faire tout cela. L’obligation de quitter le territoire est définitive. Après, on devient un jeune célibataire et, donc, un très mauvais dossier. On n’a pas de formation, donc on ne peut même pas espérer une régularisation de carte «salarié».
Beaucoup de jeunes perdent l’occasion d’avoir des papiers à dix-huit ans parce qu’ils ne sont pas soutenus. Il faut vraiment faire un effort pour ces jeunes-là. Souvent, leurs parents sont dépassés. Ils n’ont personne. Certains professeurs s’impliquent beaucoup. Cette semaine, nous avons été confrontés à un professeur qui voulait écrire une lettre au juge. Nous lui avons expliqué qu’il faudrait plutôt faire une requête en annulation d’obligation à quitter le territoire. C’est un travail d’avocat. Ce n’est pas une lettre au juge qu’il faut faire. Le juge trouvera cela sûrement sympathique, mais rejettera la requête parce que c’est trop léger.
Bahija Benkouka
Une campagne concernant les jeunes majeurs est menée par RESF.
Public
À Paris, onze jeunes majeurs remplissaient tous les critères et ils viennent tous de recevoir une OQTF (obligation de quitter le territoire français). De ce point de vue, il faut quand même rappeler que la loi a changé. Autrefois, pour les APRF (arrêté préfectoral de reconduite à la frontière), on pouvait faire le recours en trois lignes. Il n’y avait pas besoin d’être avocat. Pour les OQTF, sans avocat, on ne peut pas faire le recours. D’ailleurs, si on dépose un recours pour ces fameux OQTF qui n’est pas rédigé par un avocat, cela passe à la procédure de tri. La procédure de tri est vraiment une «jolie» invention... Elle ne concerne pas que les sans-papiers. Elle concerne tout le monde. Si on a un souci avec son propriétaire, si on rédige mal le recours au tribunal administratif, il va à la poubelle. Le tri, c’est 10% des recours au tribunal qui sont jetés. Et les dossiers de sans-papiers n’échappent pas au tri. C’est arrivé récemment avec une famille que je suis. Cela fait je ne sais plus combien d’années qu’ils sont là. On nous a dit que le recours ne serait pas examiné. Point. Cela arrive de plus en plus. Le recours au tribunal ne fonctionne donc pas toujours. On peut quelquefois gagner au tribunal, mais on gagne un réexamen de la situation et, s’il n’y a pas de mobilisation, s’il n’y a pas de soutien en préfecture, on reçoit un deuxième OQTF. Rien n’empêche la préfecture de balancer des OQTF tous les ans et d’envoyer les gens au tribunal tous les ans. Et cela peut durer vingt ans.
Bahija Benkouka
J’ai vu des gens pour qui des arrêtés de reconduite ont été annulés. La préfecture a fait appel. C’est arrivé jusqu’au Conseil d’État. Et les gens n’ont pas obtenu de papiers. La préfecture qui, normalement, doit appliquer la loi ne l’applique pas. C’est vraiment scandaleux et contradictoire.
Public
Je voudrais revenir sur les différentes interventions. Concernant l’intervention d’Éric Lecerf, certes, si on est lucide, on peut être pessimiste. Mais il faut continuer le combat sans se décourager, tout en étant réaliste sur ce qui se passe. Des éducateurs avaient fait grève pour protester contre le fait qu’on leur demandait de dénoncer des choses. Ils sont allés contre leur hiérarchie et se sont mobilisés.
En ce qui concerne les sans-papiers, j’étais à l’université Paris-8 quand des sans-papiers inscrits cherchaient à être régularisés. J’ai assisté à des luttes dans les années quatre-vingt-dix. C’était moins dur que maintenant.
Maintenant, ce qui va se passer avec Sarkozy, pour tous les étudiants, les bourses sont sur dix mois et on vérifiera aussi qu’ils sont assidus. Cela existait pour les sans-papiers, cela existera pour tous les étudiants. Ce sont des convergences.
J’admets que les convergences sont très faibles. C’est vrai. Mais on peut agir au niveau pratique. Dans certains cas, on peut construire des convergences avec les gens qui interviennent, les éducateurs, les enseignants, au niveau administratif aussi, les étudiants, les collectifs de sans-papiers, les syndicats qui bougent – différentes tendances à l’intérieur d’un syndicat peuvent se faire la guerre pour bouger ou ne pas bouger.
Ce qui est bien aussi, c’est de publier des textes et de les publier en d’autres langues. Au 9e Collectif, nous avons écrit un texte. SUD et la CGT en avaient rédigé aussi. C’était un quatre-pages sur les travailleurs. Ce serait bien de faire des choses comme cela. Les convergences sont possibles. Bien sûr, c’est loin d’être suffisant, vu la situation.
Ce que vous dites est vrai: tout le monde va bientôt être précarisé. On le disait déjà il y a six ou sept ans. C’était les travailleurs sans-papiers qui étaient visés – je n’aime pas dire seulement les travailleurs sans-papiers, il y en a qui ont des périodes sans travail aussi. Il faudrait parler aussi des travailleuses sans-papiers, personnes isolées et celles qui travaillent dans les hôtels. Elles travaillent avec les syndicats. Certaines étaient présentes pendant le dernier mouvement rue du Chemin-Vert.
Eric Lecerf
Je n’étais pas du tout pessimiste. Nous tous, qu’est-ce qui nous amène à être militants? C’est d’abord le fait de l’incapacité de vivre à côté d’une injustice. Sur la question de la convergence, ce que vous dites est très juste. Normalement, je ne devrais pas en parler puisque je suis spécialiste du travail, notamment sur la fondation du monde ouvrier en tant qu’historien et philosophe. Bien évidemment, la réflexion s’articule. Je prends un exemple. Au moment des émeutes, Sarkozy déclare que 90% des jeunes sont des récidivistes. Le lendemain, un journaliste fait quand même remarquer à la ministre que ce n’était pas vrai. On a dit au tribunal de Bobigny que c’était plutôt l’inverse, que seulement 10 % avaient un dossier en justice et, parmi ces 10%, certains au titre de victimes. À ce moment-là, la ministre a dit: «Oui, mais, en vérité, sa déclaration portait sur ceux qui étaient connus par la police.» C’était la première fois que c’était prononcé. On a assisté à la rupture totale de l’État de droit de Montesquieu. La séparation des pouvoirs disparaissait. La gauche n’a rien dit. Depuis, c’est devenu un concept généralisé. «Connu par les services de police», c’est n’importe lequel d’entre nous. C’est clair. On voit bien là que, dans le cadre de la rupture de l’État de droit, un pouvoir qui abuse – tout pouvoir abuse –, un pouvoir qui n’est pas limité dans sa volonté d’agir, de toute façon, cela concerne tout le monde. On peut donc dire que, pour nous, en plus de cette idée que nous ne pouvons pas vivre à côté de l’injustice, qui évoque l’idée d’un horizon politique, le sans-papiers est un abcès de fixation, un lieu de cristallisation tout à fait particulier qui dévoile ce qu’est la société.
Ce que je voulais dire, c’est qu’il ne faut pas non plus se raconter des histoires. D’abord, pour qu’il y ait convergence de luttes, il faut qu’il y ait lutte. Et, pour qu’il y ait lutte, il faut que les gens soient concernés par des choses qu’ils peuvent identifier. Je prenais le cas de l’université pour montrer que, d’une certaine façon, on a une possibilité de faire jouer cette chose, pour moi, idéale, qui est une universalité du genre humain, c’est-à-dire, foncièrement, une liberté totale de circulation. C’est exactement comme la régularisation par le travail, lancée par la CGT. À la fois, c’est un vrai problème et c’est un coin enfoncé dans les préfectures. Ce mouvement-là apporte quelque chose et, en même temps, il met en difficulté d’autres choses. De la même façon, quand nous allons nous battre pour faire reconnaître cette universalité de toute personne qui vient faire des études, on porte quelque chose qui est une valeur et, à la fois, immédiatement, on réserve cette valeur à des gens qui ont des diplômes. Moi qui ai commencé ma vie professionnelle sans aucun diplôme, comme ouvrier, cela me pose problème. Sur ce plan-là, ce n’est pas évident. Je ne suis pas du tout pessimiste, au contraire. Mais il faut prendre de face ce genre de contradictions. Il ne faut pas faire comme si notre discours rationnel fonctionnait et que, simplement, les gens ne comprenaient pas.
D’abord, tous autant que nous sommes, la raison qui nous fait nous battre – je parle là, vous l’entendez bien, comme quelqu’un qui n’est pas un sans-papiers –, c’est d’abord non pas la charité ou la compassion, mais un esprit de justice. C’est quand même ce qui nous anime d’abord. Tout à l’heure, je disais que cet esprit n’était pas rationnel. Encore une fois, pour moi, ce n’est pas une critique. C’est foncièrement que l’on est ailleurs. Certes, après, on peut construire un discours, on peut prendre des cas, on peut avancer sur la question du droit, sur la question du travail.
Bahija Benkouka
La convergence est possible. Cela ne doit pas rester un slogan. Cela se construit sur le terrain. Il faut trouver les liens que l’on peut faire avec d’autres luttes: par exemple, les étudiants étrangers sans-papiers, l’action de Réseau éducation sans frontière sur le terrain, les travailleurs sans-papiers et les autres travailleurs salariés. Il faut vraiment travailler de manière stratégique et pédagogique pour que cela se fasse. Et cela peut se faire. Mais il faut qu’il y ait lutte, qu’il y ait un travail de jonction entre les luttes.
Public
Ainsi que vous le disiez, il faut associer à toutes les démarches juridiques une démarche politique. Je pense que c’est une dimension dont on ne peut pas se passer.
Bahija Benkouka
Il faut comprendre l’arsenal juridique.
Public
Ce que je trouvais beau et intéressant, c’est précisément de faire apparaître cette lutte comme un travail qui, finalement, s’est construit pendant de nombreuses années et qui s’est développé. C’est finalement en parlant de ce travail et de cela comme un travail que cela prend une épaisseur. À ce moment-là, il y a tout un chemin qui se fait. Il y a une existence, une réalité qui se transforme.
1 – Réalisé en 2009, Les Racines du brouillard est un récit à trois voix qui ont partie liée avec l’histoire de l’indépendance de l’Algérie. Le film projeté en deuxième partie de soirée a donné lieu à une discussion avec les spectateurs que nous ne retranscrivons pas ici.